1. Qu’est-ce que l’hydrogène ?
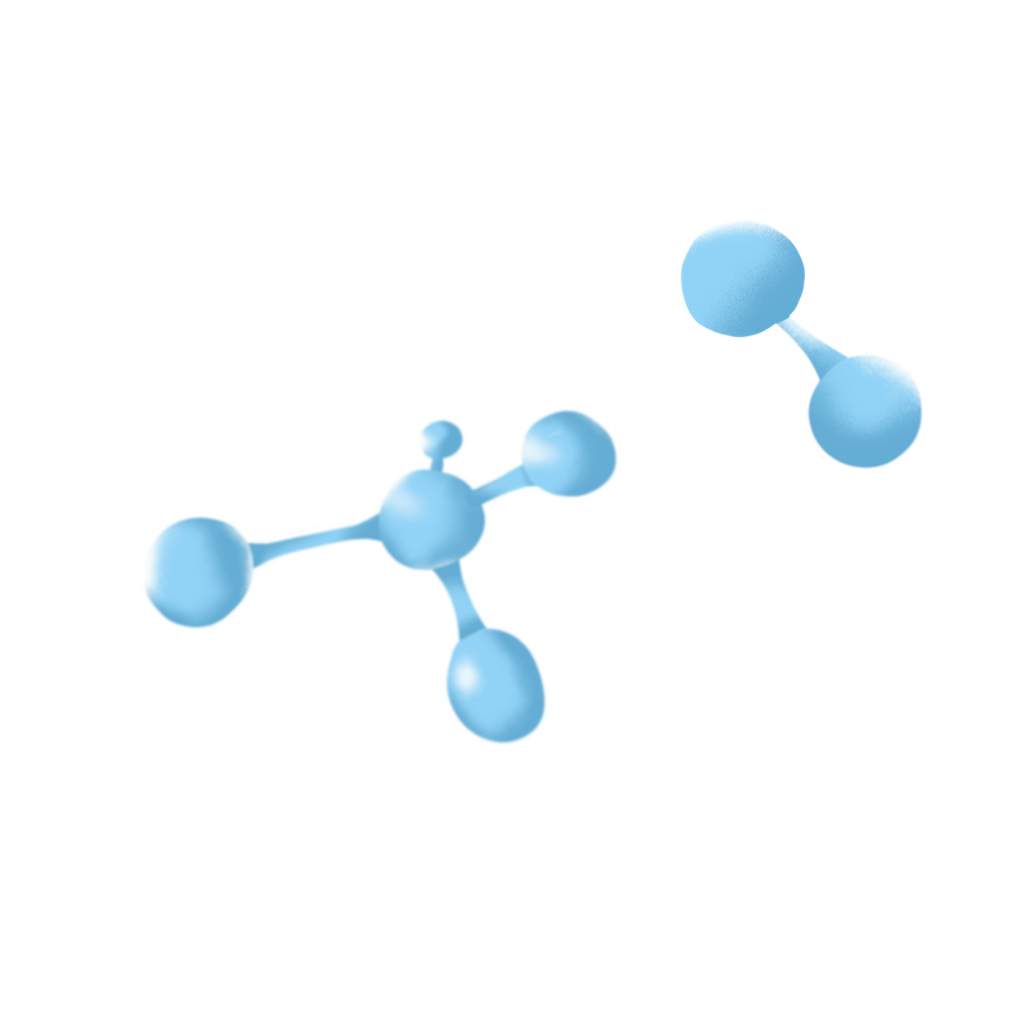
L’hydrogène est un gaz présent naturellement et figure parmi les éléments les plus répandus dans l’univers. C’est le fameux « H2 » que l’on retrouve dans la composition de l’eau (H₂O). Son histoire dans les transports et l’industrie remonte au XVIIIᵉ siècle, où il était principalement utilisé comme gaz porteur pour les ballons. Dans les années 1950, la NASA a ouvert la voie en employant de l’hydrogène liquide comme carburant de fusée et en utilisant des piles à hydrogène pour alimenter ses engins spatiaux en électricité.
Aujourd’hui, l’hydrogène intervient dans de nombreux procédés industriels, comme la fabrication d’engrais, de médicaments, ou encore le raffinage du pétrole. Avec l’urgence climatique et la recherche de solutions énergétiques durables, l’intérêt pour l’hydrogène s’est considérablement renforcé. On l’envisage désormais comme un carburant propre pour les transports, un moyen de stocker l’énergie ou encore une alternative dans certaines industries.
L’un de ses grands atouts : lorsqu’on l’utilise, il ne rejette aucun gaz à effet de serre, seulement de l’eau. Mais attention, l’hydrogène n’est pas toujours vert !
2. Qu’est-ce qui distingue l’hydrogène vert de l’hydrogène gris ou bleu ?
La différence entre les types d’hydrogène – souvent désignés par des couleurs – tient à la manière dont ils sont produits. L’hydrogène vert est obtenu par électrolyse grâce à de l’électricité issue de sources renouvelables. Résultat : aucune émission de gaz à effet de serre. À l’inverse, l’hydrogène gris est fabriqué à partir d’énergies fossiles, principalement du gaz naturel, ce qui entraîne d’importantes émissions de CO₂. L’hydrogène bleu, lui, repose aussi sur des énergies fossiles, mais il intègre un système de captage du carbone pour limiter, en partie, les rejets polluants.

Aujourd’hui, près de 96 % de l’hydrogène produit dans le monde provient encore d’énergies fossiles : 62 % à partir de gaz naturel sans captage du carbone (CCUS) et 21 % à partir du charbon. Ce mode de production reste donc très polluant.
La Banque Triodos, elle, soutient exclusivement l’hydrogène vert. Comme le souligne Matija Kajic, chercheuse en durabilité : « Aujourd’hui, à peine 4 % de l’hydrogène produit est vert. Cela représente une immense opportunité de transition : les industries qui utilisent encore de l’hydrogène gris ou d’autres énergies fossiles peuvent évoluer vers l’hydrogène vert. »
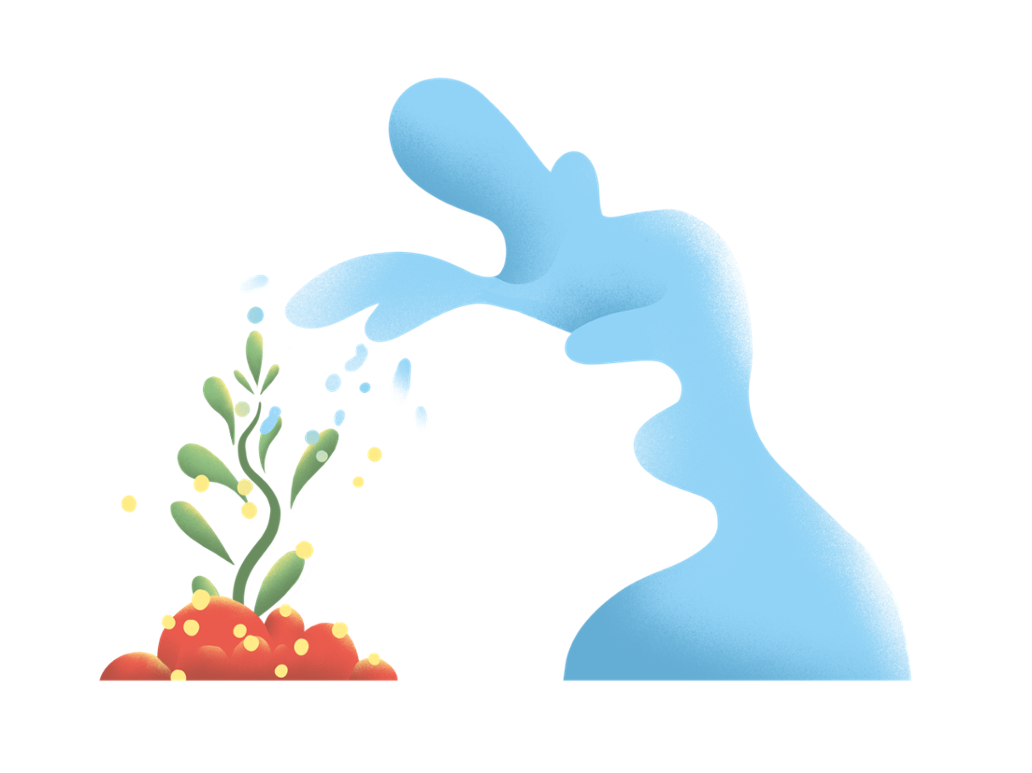
3. Quelles sont les principales utilisations de l’hydrogène ?
L’hydrogène occupe une place clé dans les raffineries de pétrole, où il permet de réduire la teneur en soufre des carburants et de produire des combustibles qui polluent moins à la combustion. En dehors du secteur énergétique, il est largement utilisé comme matière première, notamment dans la fabrication d’engrais, de médicaments, dans l’industrie électronique pour les semi-conducteurs, ou encore dans certains procédés de raffinage des métaux.
Matija Kajic précise : « Ce qui compte vraiment pour nous, c’est la façon dont l’hydrogène vert est utilisé. Des pays comme l’Allemagne, avec leur Stratégie nationale pour l’hydrogène, misent sur cette technologie pour décarboner l’industrie et réduire les émissions liées au transport longue distance. On espère simplement qu’ils ne vont pas davantage réduire les budgets alloués à cette stratégie, car cela correspond tout à fait à la vision de l’hydrogène vert que nous soutenons. D’autres pays, comme le Japon, s’y intéressent aussi, mais en se concentrant davantage sur les transports à hydrogène, en particulier les véhicules à pile à combustible. »
4. Les voitures à hydrogène vert vont-elles bientôt devenir la norme ?
Pas vraiment. Cela reste aujourd’hui trop complexe et trop onéreux, comme l’explique Joeri Van Mierlo, professeur au centre de recherche MOBI sur l’électromobilité (VUB). « Pour faire rouler une voiture à l’hydrogène vert, il faut d’abord produire de l’hydrogène à partir d’énergies renouvelables, puis comprimer le gaz, et enfin le transformer en électricité dans la voiture via une pile à combustible. Toutes ces étapes intermédiaires entraînent d’importantes pertes d’énergie : au final, il faut près de trois fois plus d’énergie que pour recharger la batterie d’une voiture électrique classique – et cela revient donc environ trois fois plus cher. Cela fait des décennies qu’on nous promet “l’arrivée de la voiture à hydrogène”, mais cette promesse vient surtout de l’industrie automobile, qui cherche à prolonger la vie des moteurs thermiques. C’est davantage du lobbying que de la science, à mes yeux. »
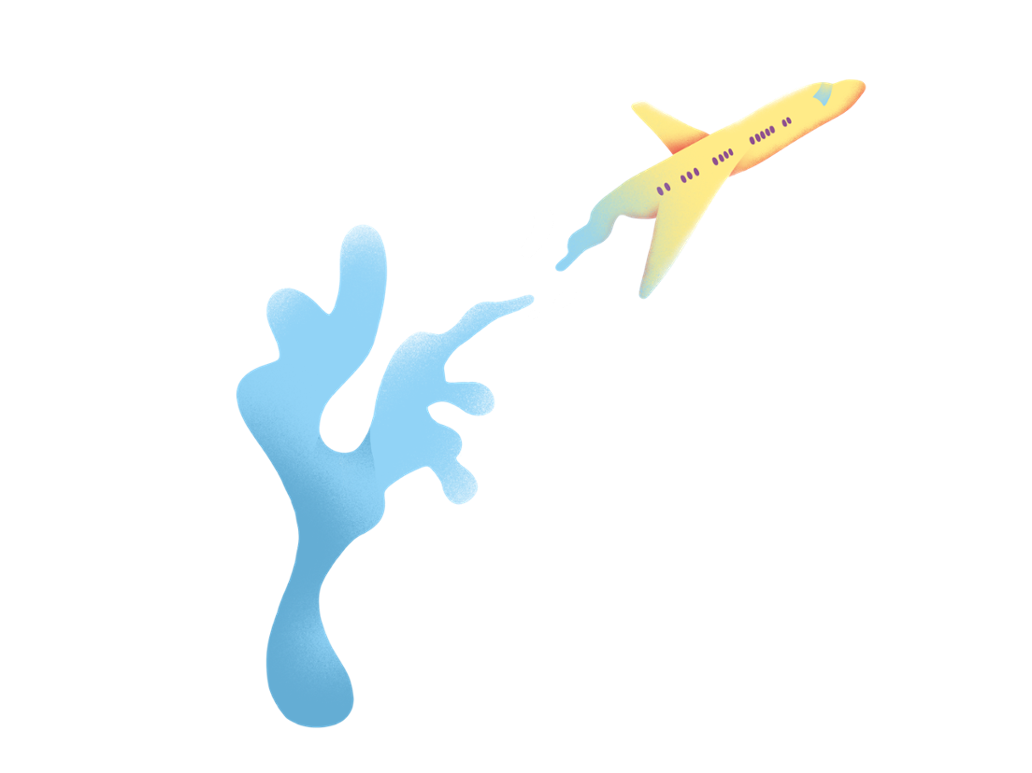
Pour le professeur Van Mierlo, le véritable intérêt de l’hydrogène vert dans le domaine des transports se trouve ailleurs : « Un vol Bruxelles–New York ne sera pas réalisable de sitôt avec un avion électrique. Dans ce genre de cas, l’hydrogène peut vraiment faire la différence. » Il insiste aussi sur la rareté de l'hydrogène vert et la nécessité de bien cibler ses usages : « Si l’on veut une économie neutre en CO₂, il faudra remplacer tous les combustibles fossiles, pas seulement dans les transports, mais aussi pour le chauffage, les procédés chimiques, l’industrie, etc. C’est une transition d’une ampleur énorme. Utilisons donc l’hydrogène vert là où il est le plus pertinent : pour remplacer l’hydrogène gris existant, ou pour stocker durablement l’électricité verte. »
5. Quel rôle l’hydrogène vert peut-il jouer dans la transition énergétique ?

L’hydrogène vert peut aider à mieux équilibrer l’offre et la demande en énergie, un défi majeur avec les énergies renouvelables, qui restent par nature variables : il n’y a pas toujours du soleil ou du vent, et la production d’électricité ne coïncide pas forcément avec les besoins. Dans ce contexte, l’hydrogène vert peut jouer un rôle clé en servant de solution de stockage à long terme. Lorsqu’il y a un surplus de production renouvelable, on peut utiliser cette électricité excédentaire pour produire de l’hydrogène par électrolyse et ainsi la stocker. Ensuite, lors des périodes de faible production ou de forte demande, cet hydrogène peut être reconverti en électricité grâce à des piles à combustible, ou bien servir dans d’autres secteurs, par exemple comme matière première pour la fabrication d’engrais ou de médicaments.
6. Cela ne fait-il pas concurrence au stockage par batteries ?
Non, au contraire : le stockage d’énergie par hydrogène vert vient plutôt compléter celui par batteries. Les batteries sont idéales pour gérer les variations à court terme (de quelques secondes à quelques heures). Elles sont très efficaces, mais dès qu’il s’agit de stocker de grandes quantités d’énergie ou sur de longues périodes, les coûts grimpent rapidement. Leur rôle principal est donc d’absorber les fluctuations de la production renouvelable au fil de la journée. L’hydrogène, lui, est mieux adapté au stockage de long terme, voire saisonnier. Certes, son rendement est plus faible puisqu’il faut transformer l’électricité en hydrogène, puis à nouveau en électricité, mais il permet de stocker d’énormes volumes d’énergie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans pertes importantes.
7. Que font les décideurs politiques ?
La guerre en Ukraine a rappelé à l’Europe l’importance de garder la main sur son approvisionnement énergétique. Depuis, la dépendance au gaz russe a nettement diminué, notamment grâce au plan REPowerEU lancé par l’Union européenne en 2022, qui vise à stimuler la production et l’importation d’hydrogène vert. Dans sa directive sur les énergies renouvelables, l’UE accorde également une place de choix à l’hydrogène vert, surtout pour l’industrie et les transports : d’ici 2035, 60 % de l’hydrogène utilisé par l’industrie devra être vert.

Antoine Louis, en charge des relations pour les projets d’énergie renouvelable à la Banque Triodos, souligne : « Ce qui est intéressant dans cette directive, c’est qu’elle impose aux producteurs d’hydrogène vert de conclure des contrats avec de nouveaux producteurs d’énergie renouvelable. Cela permet donc aussi de booster la production d’énergie verte. » Reste à voir si ces ambitions se concrétiseront vraiment : selon la Cour des comptes européenne, il y a encore beaucoup de bonnes intentions, mais pas assez d’objectifs précis et réalisables.
8. Ne vaudrait-il pas mieux utiliser directement l’électricité verte, plutôt que de la transformer en hydrogène avant de la reconvertir en électricité ?

Transformer l’électricité verte en hydrogène puis la reconvertir en électricité entraîne effectivement des pertes d’énergie, ce qui peut sembler contre-productif. C’est justement pour cette raison qu’il est important de réserver l’hydrogène aux usages vraiment pertinents : par exemple, pour stocker durablement les surplus d’électricité renouvelable (voir question 6), ou pour remplacer l’hydrogène gris utilisé aujourd’hui dans certaines industries.
Matija Kajic explique : « À la Banque Triodos, nous pensons qu’il faut faire preuve de sobriété énergétique, et utiliser l’électricité verte aussi directement que possible, sans passer par des étapes supplémentaires qui gaspillent de l’énergie. Mais dans certains secteurs où l’hydrogène est une matière première indispensable, il représente une chance unique de décarboner des industries lourdes. Pensons aux secteurs de l’acier, de l’aluminium, du transport maritime ou routier... S’ils passent à l’hydrogène vert, c’est toute la société qui en bénéficiera. C’est pour cela que nous choisissons de soutenir ces projets. »
9. L’hydrogène vert a-t-il d’autres inconvénients ?
Comme toute technologie émergente, l’hydrogène vert doit encore relever de nombreux défis, à commencer par son coût : il reste aujourd’hui plus cher que les autres types d’hydrogène. Côté infrastructures, il faut mettre en place de nouveaux gazoducs, des installations de stockage et des stations de ravitaillement pour permettre son transport et sa distribution en toute sécurité. Il y a aussi la question de la consommation d’eau : produire un kilogramme d’hydrogène par électrolyse nécessite environ 9 litres d’eau purifiée.
10. Quelles mesures sont mises en place ?
Le facteur temps est essentiel. À ce stade, il s’agit surtout de produire de l’hydrogène vert en utilisant l’électricité renouvelable qui, sinon, serait perdue lorsque le réseau ne peut pas tout absorber. Ensuite, les perspectives vont s’élargir, comme l’explique Matija Kajic : « Au fur et à mesure que le système électrique se décarbone – on atteindrait environ 70 % d’énergie décarbonée d’ici 2030 selon les projections –, le rôle de l’hydrogène va évoluer. À ce moment-là, il faudra déployer massivement des électrolyseurs pour transformer l’excédent d’électricité verte en hydrogène, ce qui permettra d’aller plus loin dans la décarbonation de l’industrie, des transports et du stockage énergétique à long terme. Évidemment, des projets pilotes sont indispensables dès maintenant, pour tester la technologie, sécuriser les chaînes d’approvisionnement et résoudre les problèmes opérationnels avant de passer à une adoption à grande échelle. »


Merci pour votre commentaire!
Confirmez votre commentaire et cliquant sur le lien que vous avez reçu par e-mail